Et si on osait enfin nommer ce que tant de femmes vivent en silence ?
Derrière les murs, une réalité silencieuse
Dans le huis clos de certaines relations, loin des vitrines rouges et des ruelles sombres, se cache une forme de prostitution invisible : la prostitution conjugale. Une réalité insidieuse, rarement nommée, mais tristement répandue. Elle ne se négocie pas à l’heure, ne s’achète pas avec des billets, mais avec du confort, une sécurité apparente, un toit, une fausse paix.
Ici, le corps de la femme n’est pas vendu à des inconnus. Il est loué en silence au quotidien, au sein même de ce que la société appelle “le couple”. Elle donne accès à son intimité, à son corps, à son énergie sexuelle, non pas par désir, mais par devoir. Pour éviter un conflit. Pour garder la paix. Pour ne pas perdre les avantages matériels, ou simplement par peur de la solitude, du rejet, ou de la précarité.
Ce troc émotionnel, cette forme de résignation, n’a rien à voir avec l’amour ou l’épanouissement mutuel. C’est une soumission intériorisée, enracinée dans des générations de conditionnement, où l’on a appris à certaines femmes qu’il valait mieux « fermer les yeux » que remettre en question le confort de leur prison dorée.
Le consentement gris — entre obligation et survie
On parle souvent du consentement comme d’un “oui” ou d’un “non”. Mais dans la prostitution conjugale, le consentement est flou, trouble, embrouillé par le devoir conjugal, la peur des conséquences, la dépendance financière, ou la simple fatigue émotionnelle.
Elle dit oui, mais elle pense non.
Elle se laisse faire, mais elle ne ressent rien.
Elle répond à un besoin qui n’est pas le sien.
Combien de femmes offrent leur corps sans plaisir, sans envie, dans une routine désincarnée où l’acte sexuel devient un “service rendu” pour maintenir l’équilibre du foyer ? Combien se taisent pour ne pas être accusées de froideur, de désintérêt, ou pire encore, de « négligence conjugale » ?
La prostitution conjugale se loge dans cette zone grise. Elle s’installe dans les silences. Elle se perpétue dans le « je n’ai pas envie, mais je dois », dans le « ça ne dure que quelques minutes », dans le « si je dis non, il va bouder, me punir ou me priver d’affection ».
Ce n’est pas un viol au sens juridique. Ce n’est pas une agression au sens brut.
Mais c’est une trahison du corps, une violence douce, pernicieuse, répétée.
Sortir de l’échange, retrouver le respect
Briser le cycle de la prostitution conjugale, c’est oser nommer l’invisible. C’est reconnaître que dans un couple, l’intimité ne peut jamais être exigée, attendue ou marché. Elle doit naître du désir librement consenti, du lien authentique, de l’égalité émotionnelle.
Sortir de ce modèle, c’est refuser de troquer son corps contre un confort, contre la peur d’être seule, contre une forme de sécurité toxique.
C’est aussi, parfois, renoncer à une relation qui repose sur le devoir plutôt que sur la réciprocité.
Et c’est là que le chemin commence : quand une femme dit non, sans culpabilité.
Quand elle comprend que son corps ne doit jamais être la monnaie d’un “bon couple”.
Quand elle exige d’être vue, aimée, respectée dans son entièreté — et pas seulement dans sa capacité à satisfaire ou à obéir.
La prostitution conjugale ne se dénonce pas toujours par des cris. Elle se dévoile dans l’usure, dans le regard éteint, dans les nuits sans âme.
Mais lorsqu’on ose la reconnaître, on ouvre la porte à une autre forme de relation : une relation où l’on ne donne plus son corps pour survivre, mais où l’on partage son être pour vivre, vraiment.
Référence légale importante (Canada)
Depuis 1983, le Code criminel du Canada ne reconnaît plus l’immunité au sein du mariage :
Un conjoint peut être accusé de viol.
Le consentement est requis à chaque relation sexuelle, peu importe le statut conjugal.
La Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacun :
- L’intégrité de sa personne (article 7)
- Le droit de vivre à l’abri de la coercition et de la violence (article 15, égalité)
Et pourtant, dans bien des foyers, le mot « non » n’est pas recevable.
Pas physiquement, peut-être. Mais moralement ? Émotionnellement ? Financièrement ? C’est souvent impensable.
Références en droit québécois
- Le Code civil du Québec mentionne que les conjoints doivent vivre dans le respect (art. 392), mais ne peut obliger l’intimité.
- La Jurisprudence canadienne reconnaît que la pression psychologique, le chantage affectif ou matériel peuvent invalider le consentement sexuel.
Pas de vrai « oui », sans vraie liberté.
Tu veux mon corps ? Commence par vouloir mon bien-être.
Et si aimer, c’était d’abord ne rien exiger ?
Et si c’était le moment de poser les vraies questions ?
Et si, au lieu de répéter des modèles éculés, on prenait un instant pour se demander : la vie de couple est-elle encore essentielle ? Est-elle toujours source d’épanouissement, ou est-elle devenue une case à cocher, un contrat social plus qu’un choix conscient ?
Avec un taux de natalité historiquement bas, des séparations qui dépassent les 50 %, des enfants ballotés entre deux foyers dès leur plus jeune âge, des cas d’aliénation parentale en hausse, et une DPJ débordée comme jamais… il devient urgent de se questionner.
Et si demain, l’État retirait les allocations familiales et les pensions alimentaires, seriez-vous vraiment surpris de voir encore moins d’enfants naître au Québec ?
Parce que, soyons lucides : faire des enfants est devenu, pour certains, un geste économique, une stratégie de survie ou d’accès à une forme de sécurité financière — et non toujours un acte profondément désiré ou réfléchi.
La famille traditionnelle, nucléaire, vacille, mais au lieu de la réparer à coups de lois ou d’incitatifs, peut-être faudrait-il d’abord repenser nos fondations.
Se demander si l’amour véritable, l’engagement, la parentalité — ça peut (ou doit) encore prendre la forme d’un couple, ou si une autre voie est possible.
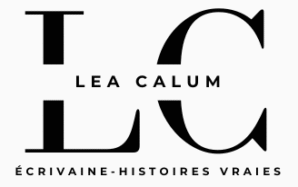



Le « couple » est clairement une belle programmation de société et qui, de plus en plus, n’est pas (et n’a peut-être jamais été) satisfaisant pour les femmes. Plusieurs hommes, voire la majorité des hommes, croient innée l’accessibilité physique d’une femme pour leur propre plaisir et comme « free labor » dans un foyer. De plus en plus de femmes sont en train de voir que cette formule ne fait plus de sens et la rejete. J’ai de la difficulté à trouver un seul couple autour de moi dont j’envie la relation… La vie, c’est tellement plus que l’illusion de protection et confort d’un couple… Les femmes en couple que je connais ne sont pas heureuses. Elles sont en mode auto-pilote.
« Je te lis et je ne peux que te rejoindre sur bien des points. Le modèle du couple tel qu’on nous l’a vendu est en train de s’effriter — et tant mieux. Il faut avoir le courage de nommer l’injuste, le déséquilibre, les rôles usés jusqu’à la corde. Mais je crois encore en l’amour libre, conscient, construit dans le respect et la responsabilité partagée. Pas l’amour par défaut. Pas le couple refuge. La solitude choisie peut être mille fois plus nourrissante qu’un couple subi. Et si demain on devait réinventer ce lien, je veux croire qu’on pourrait le faire à notre image. »
— Léa
Votre postulat de départ est que Désir et plaisir sont forcément corrélés chez toutes les femmes. Un jour une collègue de travail de mon âge (56 ans) m’a dit : « parfois on en a pas envie spécialement au début mais c’est bien quand même finalement « . Tout est dit. À partir du moment où l’on décide de faire du sexe un enjeu politique, économique ou de pouvoir, les cartes sont truquées. Si une femme consent à avoir des rapports avec son compagnon sans en éprouver du plaisir c’est qu’elle se place d’emblée dans une relation transactionnelle : si elle n’a jamais ressenti de plaisir avec son compagnon, mari, partenaire c’est encore plus clair. Par ailleurs je vais peut être vous l’apprendre mais un homme peut avoir une érection sans éprouver de désir et certaines femmes ont des besoins sexuels important et se contentent de la disponibilité physique de leur partenaire. Les représentations des deux sexes sont biaisées par beaucoup d’a priori culturels : l’absence d’éjaculation chez un homme à l’issue d’un rapport n’ est jamais l’objet d’une remise en cause de sa partenaire qui peut tout à fait atteindre l’orgasme entre temps. Un homme peut tout aussi bien consentir à un rapport sexuel même s’il n’en a pas envie contrairement à des préjugés tenaces (qui sont des préjugés patriarcaux d’ailleurs qu’un certain discours féministe fait perdurer en oubliant qu’ils devraient également faire l’objet d’une déconstruction). Il y a des femmes incapables de concevoir une amitié sincère hétéro sexuelle et qui percevront cette amitié comme un challenge ou comme l’aveu d’une défaillance ou d’une homosexualité latente de leur ami. Combien d’hommes oseront en parler ? Alors que les forums sont remplies de témoignages sur les hommes bloqués dans la « friendzone » j’attends encore les témoignages de femmes qui auraient le courage d’avouer être dans la même situation vis à vis d’un homme qu’elles désirent/convoitent (parce que s’il n’a pas envie de moi c’est qu’il est gay ou qu’il
a quelqu’un)…et je ne parle pas de vedettes du cinéma ou du spectacle mais d’hommes qu’elles côtoient…Il y a aussi des enjeux de pouvoir et de gratification narcissique dans la séduction féminine que vous l’admettiez ou non.
Votre réflexion est très juste et nuancée, et j’apprécie la manière dont vous abordez le sujet sans tomber dans les clichés.
Effectivement, la question du désir et du plaisir dépasse largement la biologie, elle touche aux constructions sociales, aux blessures, à la perception qu’on a de soi et de l’autre.
Ce que vous soulevez sur les rapports de pouvoir, la disponibilité, ou même la réciprocité du consentement, montre une vraie lucidité.
C’est rare d’échanger avec quelqu’un qui pense au-delà des apparences. Merci pour cette perspective.