Au moment où j’écris ces lignes, le président des États-Unis, Donald Trump, vient d’annoncer une hausse mondiale des tarifs douaniers.
Peut-être me demanderez-vous : « Quel rapport avec la superficialité, Léa ? »
Mon raisonnement est simple.
Sur les réseaux sociaux défilent des messages alarmants : pertes d’emploi, marchés boursiers en chute, inflation galopante. Je ressens la peur s’installer, surtout chez nos aînés. Cette inquiétude collective me touche, car j’ai moi-même été secouée par la crise financière de 2008, puis par la pandémie de la COVID-19. Deux secousses majeures qui ont fissuré bien des illusions, dont les miennes.
À cette époque, j’étais une femme prisonnière des apparences. Toujours à l’affût de la dernière tendance, soucieuse de rouler dans un véhicule luxueux, de porter des marques prestigieuses, de montrer au monde que “tout allait bien”.
Mais au fond, je consommais pour combler un vide. Je travaillais pour acheter, et j’achetais pour me rassurer.
La vérité ? Je n’avais pas besoin de tout ça.
Ce que la vie m’a enseigné — parfois durement — c’est que je m’éloignais de moi-même. J’accumulais les biens matériels sans jamais me demander s’ils avaient un sens. Tout cet argent, toutes ces ressources, j’aurais pu les investir autrement : dans ma paix d’esprit, dans un filet de sécurité pour les jours sombres. Mais à l’époque, je courais après l’image, pas après l’essentiel.
La superficialité m’a éloignée de ce qui compte : la sécurité intérieure, la stabilité, la clarté de conscience.
Aujourd’hui, j’ai choisi un autre chemin. Une vie alignée, libérée du regard des autres, enracinée dans le réel.
Je ne cherche plus à impressionner, je cherche à vivre pleinement.
La superficialité se glisse dans bien des sphères de nos vies, subtilement, insidieusement. Mais lorsqu’on la dépouille, qu’on ose se confronter au vrai, une liberté inattendue émerge. Je dors paisiblement, sans crainte du lendemain.
Les menaces économiques glissent sur moi comme la pluie sur la pierre.
L’inflation, loin de m’affaiblir, m’enrichit. J’ai appris à manœuvrer là où d’autres vacillent.
Quand certains perdent, je gagne.
Les turbulences ne m’intimident plus. Je n’attends rien des gouvernements, ni des marchés. L’inflation, la hausse des taux, le coût de la vie — ces mots qui effraient tant — sont devenus pour moi des opportunités déguisées.
Là où beaucoup s’inquiètent et reculent, je trace ma route, lucide et stratégique.
J’ai appris à lire entre les lignes du chaos.
Tandis que d’autres s’effondrent, je bâtis.
La superficialité : un masque social, une fuite intérieure
Nous vivons à une époque où l’apparence règne.
Une époque où l’image est pensée, filtrée, mise en scène — sur les réseaux, dans nos relations, et même dans le regard que nous portons sur nous-mêmes.
Derrière cette quête de perfection et de maîtrise se dissimule souvent une peur silencieuse : celle d’être vu·e tel·le que l’on est.
Fragile. Incomplet·e. Vrai·e. Humain·e.
Le besoin de plaire… ou d’éviter
La superficialité ne naît pas de la méchanceté, mais de l’insécurité.
C’est un réflexe de protection. Un bouclier contre l’inconfort. On effleure les sujets, on survole les émotions, on évite les silences qui dérangent.
On fait le beau, on reste poli, on garde le contrôle. Parce qu’aller plus loin, c’est risquer de toucher quelque chose de vrai… donc de vulnérable.
Mais à force de tout adoucir, on finit par étouffer ce qui est vivant.
Et on se coupe des liens profonds — ceux qui nourrissent réellement.
La superficialité dans nos relations
« Comment ça va ? »
Une question si banale… et pourtant, si puissante. Ou si vide.
Combien de fois, chaque jour, prononçons-nous ces mots sans même les habiter ?
Et combien de fois espérons-nous qu’on ne nous réponde pas autre chose que :
« Ça va, et toi ? »
Ce petit échange automatique, ce tic social, est devenu un sas sans intention.
Un rituel creux qui nous permet de rester en surface.
Mais posons-nous une vraie question :
Suis-je capable d’entendre autre chose que “ça va” ?
Nietzsche, ce penseur sans complaisance, dénonçait cette fausse proximité qui pollue nos liens.
Ce masque poli qui nous empêche de nous rencontrer vraiment.
Et si on osait autrement ?
Et si, au lieu de répéter machinalement « Comment ça va ? », on ouvrait une porte réelle ?
Et si l’on disait :
« Comment tu te sens, vraiment ? »
« Dis-moi si t’as besoin de déposer quelque chose. »
« J’ai envie de savoir ce qui se passe pour toi. »
Parfois, il suffit d’un minuscule glissement de conscience pour créer un espace.
Une brèche.
Une respiration.
Un instant vrai.
Ce que nous cherchons tous, c’est d’être vu(e)
Dans un monde où tout va vite, être sincèrement écouté(e) devient rare.
Alors imagine la puissance de cette simple attention :
ne pas répondre par automatisme, mais oser dire la vérité, même en quelques mots.
Et de l’autre côté, oser l’accueillir.
Peut-être que l’un des plus beaux actes de rébellion, aujourd’hui,
c’est d’apprendre à poser des vraies questions.
Et surtout… à rester pour entendre et comprendre les réponses.
Avez-vous déjà eu une conversation où tout semblait parfait, mais où rien ne vibrait ?
Des mots polis, des sourires automatiques, mais aucun échange réel.
La superficialité crée de la distance. Elle protège, certes, mais elle empêche l’intimité vraie. Elle fait semblant de relier alors qu’elle nous isole.
Car ce n’est pas en parlant de tout qu’on se dit vraiment quelque chose.
Combien de gens que l’on connaît que tout va bien, tout le temps. Soyons honnête, c est faux. La vie est polarité.
Il y a toujours deux côtés à une médaille, qu’on le veuille ou non. Et chacun de ces côtés peut être perçu comme positif ou négatif, selon la manière dont on choisit de regarder les choses.
Je me souviens de mes années à l’école primaire, lorsque j’essayais de me faire des amis. J’avais, à l’époque, établi une stratégie bien précise : pour faire partie du cercle, il fallait être superficielle et hypocrite. Et je m’y suis tenue. Même si, au fond de moi, je détestais cette façon de faire.
Aujourd’hui, à 47 ans, certaines de ces amies d’enfance sont encore dans ma vie. Elles me disent que j’ai changé, et ce n’est pas un compliment à leurs yeux. Elles ne me reconnaissent plus. Et je comprends pourquoi : je suis devenue franche, authentique. Je dis ce que je pense, même si ça dérange.
On sait bien que beaucoup préfèrent les silences confortables à la vérité qui pique. Mais moi, après avoir passé quatre décennies à me taire, à enfiler le masque de la superficialité, j’ai choisi de reprendre le contrôle de ma vie. Et pour ça, il fallait que je me choisisse enfin, telle que je suis.
Assurément, ce n’est pas la meilleure façon de se faire des amis — j’en conviens. Mais avec le temps, on réalise que les vrais, ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, restent. Et ceux-là, croyez-moi, apprécieront votre présence sincère, bien plus qu’un sourire forcé.
J’éprouve aujourd’hui un certain malaise à poser la fameuse question : « Comment ça va ? » — surtout lorsqu’elle s’adresse à quelqu’un qui ne m’est pas proche. Cette formule, qu’on répète machinalement, est devenue si automatique qu’elle en a presque perdu tout son sens. Et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas toujours prête à entendre la vraie réponse derrière cette question.
Évidemment, c’est différent dans le cadre de mes accompagnements ou avec mes proches. Là, le contexte change : il y a de l’espace, de l’écoute, et surtout, une intention sincère. Les gens qu’on connaît vraiment nous connaissent aussi. Et c’est dans ces liens-là que les vrais partages peuvent émerger — parfois doux, parfois crus, mais toujours authentiques.
Un “ça va” quand ça ne va pas…
Et puis, comme si de rien n’était,
on sourit.
On hoche la tête.
On continue la conversation… sur la météo, sur les nouvelles, sur n’importe quoi de sans danger.
Satisfaits d’avoir respecté le script.
Le rituel social est accompli. On a posé la question. On a répondu.
Mais au fond, rien n’a changé.
Parce que la vérité, c’est que ça n’allait pas.
Et que personne ne l’a vu. Ou voulu le voir.
Faut se l’avouer : quand quelqu’un qu’on connaît à peine se met à nous raconter ses malheurs, notre cerveau part souvent en vadrouille. On pense à notre liste d’épicerie, à ce foutu rendez-vous qu’on va encore manquer, ou à cette réponse polie qu’on pourrait glisser sans trop s’engager. Bref, on pense à tout… sauf à ce qu’il ou elle est en train de nous dire.
Et soyons honnêtes, la plupart d’entre nous ne savent pas vraiment quoi répondre. On cherche une phrase qui a un minimum de sens, sans tomber dans le cliché ni risquer de blesser encore plus. C’est un art, l’écoute vraie. Et cet art, comme bien d’autres, n’est pas donné à tout le monde.
Seuls dans un monde ultra-connecté
On n’a jamais eu autant de moyens de se parler.
Messages instantanés. Vidéos. Stories. Emojis. les réseaux sociaux, etc…
Et pourtant, combien se sentent seuls ?
Combien s’endorment le cœur plein de non-dits ?
Combien sourient dans leurs photos et pleurent dans leur salle de bain ?
La connexion technologique ne remplace pas la connexion humaine.
L’intelligence, qu’elle soit émotionnelle ou intellectuelle, peut parfois devenir un excellent moyen de prendre ses distances. Ce n’est pas qu’on méprise les autres — mais disons que plus on comprend le monde, plus certaines conversations deviennent… épuisantes.
D’ailleurs, plusieurs études récentes le confirment : les gens s’isolent de plus en plus. Et on ne parle pas seulement des ermites dans une cabane au fond des bois. Aujourd’hui, on peut littéralement se faire des amis… en version intelligence artificielle. Un compagnon programmable, toujours disponible, jamais dans le jugement. Tentant, non ?
Je ne suis pas contre ces outils. Ils peuvent être utiles, réconfortants même. Mais je crois qu’il est important de se demander pourquoi on en vient à préférer un robot à un humain. Qu’est-ce que ça dit de nous ? Qu’est-ce que ça révèle de nos blessures relationnelles, de notre besoin de contrôle, ou de notre peur d’être déçus ?
Sans aucun jugement, je remarque parfois que certaines personnes éprouvent des difficultés à s’exprimer aisément en public. Que ce soit par timidité, manque de confiance ou simplement parce que les mots semblent se bousculer sans trouver leur place, la parole peut devenir un vrai défi. Et dans une société où l’on valorise tant l’aisance verbale, cela peut rapidement devenir une source de malaise ou de retrait. Alors, je crois que les interactions avec les robots peuvent nous conduire a ce type de malaise.
Osons réapprendre à être là
Peut-être qu’on n’a pas besoin de devenir thérapeutes.
Mais peut-être qu’on peut devenir, pour quelqu’un, un espace.
Un regard qui dit : “Je suis là si tu veux me dire que ça ne va pas.”
Et si toi aussi, tu réponds “ça va” alors que non…
Sache que tu as le droit, un jour, de dire autre chose.
Pas pour dramatiser. Mais pour ne plus porter seule ce que tu tais.
Parce qu’un vrai “comment tu vas ?”,
c’est un geste d’amour.
Et un vrai “non, ça ne va pas”,
c’est le début d’un vrai lien.
Mais sommes nous prêt a entendre la réponse?
Il y a quelques années, j’ai commencé à pratiquer l’écoute active, même envers des gens qui ne faisaient pas partie de mon cercle proche. Et là, j’ai découvert tout un autre monde — un monde d’entraide, de partages sincères, de silences qui en disent long.
Ce que j’ai compris, c’est que si une personne se confie à nous, ce n’est pas un hasard. Soit elle nous connaît bien, soit elle perçoit en nous une présence rassurante, un espace sûr, où les mots peuvent tomber sans craindre d’être jugés. Et ça, c’est précieux.
J’ai remarqué un vrai changement dans ma façon d’entrer en contact avec les gens. Au lieu du traditionnel et souvent mécanique « ça va ? », je préfère maintenant demander : « Comment se passe ta journée ? » Et c’est fou comme cette simple nuance ouvre la porte à des réponses plus authentiques.
Cela me rappelle un passage marquant du livre Les 5 grands Rêves de Vie de John P. Strelecky. Il raconte comment, en posant simplement la question « N’est-ce pas une belle journée de matinée au musée ? », il nous amène à réfléchir à notre musée personnel. Ce musée, c’est l’espace symbolique où chaque moment vécu devient une image suspendue à nos murs intérieurs. Je le recommande également dans vos prochaine lecture.
Et cette idée m’inspire profondément : que voulons-nous y exposer ? Des souvenirs grisâtres et passés sous silence ou des instants de partage, d’émerveillement, même tout simples ? Depuis, j’essaie de vivre mes journées comme si j’étais en train de peindre une fresque pour mon musée intérieur.
Rare sont ceux qui se contentent d’un « ça va ». La plupart partagent un petit bout de leur quotidien — un détail de la veille, un imprévu, une joie, une frustration. Parce que, finalement, on a tous quelque chose à raconter. Quelque chose qui a changé, évolué ou simplement marqué notre journée.
Ce genre d’échange, aussi simple soit-il, crée un lien plus vrai. Et dans ce monde où tout va vite, ça fait du bien de s’arrêter pour vraiment écouter.
Et en nous ?
Nous sommes parfois superficiels… avec nous-mêmes.
On va bien. On ne veut pas trop penser. On avance, on « gère ».
Mais à force de rester en surface, on s’épuise. Car ce qu’on n’écoute pas à l’intérieur finit toujours par se faire entendre — souvent sous forme de fatigue, d’anxiété ou de vide existentiel.
Se mentir à soi-même… une vilaine habitude, n’est-ce pas ?
On le fait tous, parfois sans même s’en rendre compte. On se persuade que tout va bien, qu’on tient le coup, qu’il suffit de « penser positif » et hop, ça ira mieux. Et combien de fois on se répète : « Lâche pas, ça va bien aller »… Oui, c’est noble comme intention, mais soyons honnêtes : ça ne suffit pas.
Je crois sincèrement que l’équilibre, c’est la vraie clé du mieux-être. Il ne s’agit pas d’être constamment dans la pensée positive, ni de sombrer dans le pessimisme. Il faut oser aller voir ce qui fait mal, ce qui pèse, ce qui ronge de l’intérieur. Parce que tant qu’on n’a pas visité nos zones d’ombre, on reste figé, comme cloué sur place. On enfile un sourire de façade, mais à l’intérieur, c’est le silence pesant des blessures non dites.
Comprendre ses douleurs, ses peurs, ses vides… ce n’est pas se victimiser. C’est se donner la chance de les apprivoiser, de les comprendre, et surtout, de reprendre le pouvoir dessus. Ce n’est qu’en accueillant ce qui fait mal qu’on peut réellement commencer à guérir.
Sortir de la superficialité, c’est choisir la profondeur
Ce n’est pas forcément tout remettre en question. C’est oser, petit à petit :
- Se poser les vraies questions
- Dire ce qu’on ressent vraiment
- Créer des liens où la vulnérabilité est permise
- Regarder sa vie avec plus de vérité que de façade
✨ La profondeur n’est pas un fardeau. C’est un souffle. Elle nous rappelle qu’on peut exister pleinement, au-delà des apparences.
Conclusion : oser revenir au vrai
Sortir de la superficialité, ce n’est pas devenir sérieux ou triste.
C’est simplement retrouver du sens, du vivant, du lien réel.
C’est choisir une vie qui touche, qui transforme, qui nourrit.
Et si nous étions nombreux à faire ce choix… peut-être que le monde redeviendrait un peu plus humain.
Bonne réflexion!
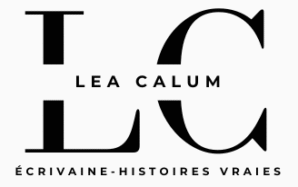



Merci pour les belles réflexions!
« Dans un monde de filtres et de façades, je choisis l’authenticité. Ce n’est pas toujours joli, ni parfait, mais c’est vrai. Et c’est dans cette vérité que je trouve ma liberté. »
— Léa